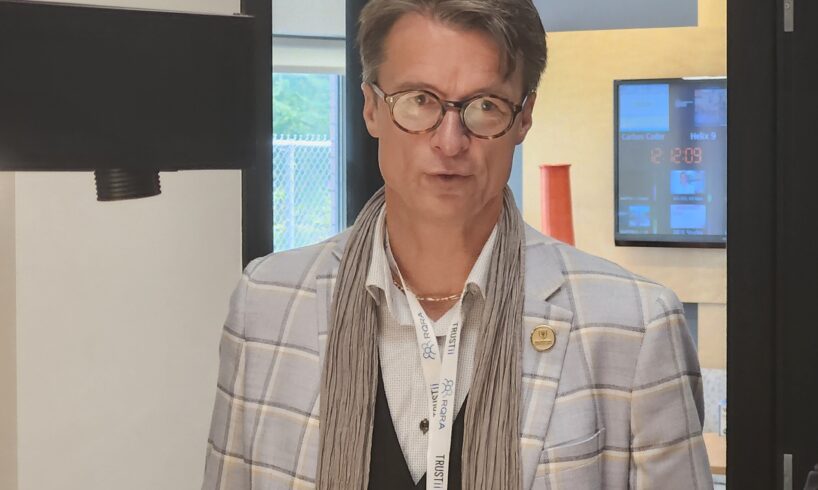
« Bayer n’a peut-être jamais perdu la bataille scientifique sur le glyphosate, mais devant le tribunal de l’opinion publique et des recours collectifs, le coût de sa défense devient tout simplement insoutenable. »
Dans un signal discret mais lourd de conséquences pour l’ensemble de l’industrie agroalimentaire mondiale, Bayer laisse entendre qu’elle envisage de cesser la production du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé sur la planète, en raison de pressions judiciaires croissantes et de compensations faramineuses à verser. Le géant agrochimique allemand a déjà mis de côté 16 milliards de dollars américains pour régler des dizaines de milliers de poursuites aux États-Unis, tout en maintenant qu’il n’existe aucun lien prouvé entre le glyphosate et le cancer. Au Canada, des recours collectifs similaires commencent à émerger.
Pour Bayer, le problème n’est pas scientifique, mais plutôt économique.
Les coûts financiers liés à la défense du glyphosate et l’atteinte à la réputation dépassent désormais sa valeur commerciale. Chaque nouveau procès alourdit la facture. La question ne consiste plus à savoir si le produit peut être défendu en justice, mais plutôt si cela en vaut encore la peine. À un moment donné, il faudra trancher et il pourrait s’avérer plus judicieux sur le plan économique de tourner la page, de développer un produit de nouvelle génération, puis de donner une nouvelle image au produit en modifiant la marque.
Cette saga remonte à 2018, lorsque Bayer a acquis Monsanto pour 63 milliards de dollars américains. L’objectif voulait créer un chef de file mondial des semences et des sciences agronomiques. Mais Bayer a probablement sous-estimé l’ampleur du passif juridique de Monsanto, notamment les poursuites liées au glyphosate et à ses présumés liens avec le cancer. Ce qui semblait à l’époque une manœuvre stratégique audacieuse est rapidement devenu l’un des rachats les plus coûteux et dommageables sur le plan de la réputation dans l’histoire des affaires.
Cela dit, cette crise représente aussi une occasion unique. Bayer pourrait tourner la page en investissant dans un nouvel herbicide offrant une efficacité agronomique tout en répondant aux exigences croissantes de durabilité environnementale et d’acceptabilité sociale. Dans un contexte où les consommateurs deviennent de plus en plus vigilants et les régulateurs de plus en plus prudents, un successeur au glyphosate, à la fois performant et socialement acceptable, redéfinirait l’héritage de Bayer et restaurerait la confiance envers la science agronomique.
Le glyphosate a longtemps constitué un pilier de l’agriculture moderne, en permettant d’augmenter les rendements, de réduire les coûts de main-d’œuvre et de favoriser l’agriculture sans labour bénéfique pour les sols. Son retrait brutal déstabiliserait toutefois les systèmes agricoles, notamment dans les pays qui dépendent fortement des outils de protection des cultures pour rester concurrentiels à l’échelle mondiale.
La controverse repose principalement sur des allégations liant le glyphosate au lymphome non hodgkinien, même si les preuves scientifiques demeurent peu concluantes. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme « probablement cancérogène pour l’humain », au même titre que la viande rouge et les boissons chaudes. Toutefois, les organismes de réglementation à travers le monde, dont Santé Canada, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), s’entendent pour dire que le glyphosate, utilisé conformément aux directives, ne présente pas de risque inacceptable pour la santé humaine.
Mais les tribunaux ne suivent pas toujours le consensus scientifique. Ils réagissent souvent à des témoignages émotionnels ou à des arguments procéduraux, rendant des verdicts spectaculaires qui négligent parfois la rigueur scientifique. Le résultat inquiète : un précédent qui a le potentiel de freiner l’innovation par crainte de poursuites judiciaires.
Le cas canadien mérite qu’on s’y attarde. Si des poursuites similaires prennent de l’ampleur ici, les agriculteurs canadiens devraient faire face à des coûts accrus et à une disponibilité réduite des outils de protection des cultures. Cela aurait des répercussions sur les prévisions de rendement, les flux commerciaux mondiaux et, ultimement, le prix des denrées alimentaires. À une époque déjà marquée par les chocs climatiques, les pénuries d’engrais et les perturbations des chaînes d’approvisionnement, toute limitation supplémentaire des intrants ferait grimper les prix encore davantage.
La sécurité alimentaire ne repose pas seulement sur la terre et la main-d’œuvre, mais aussi sur la capacité d’innover et de gérer les risques. Le glyphosate a joué un rôle essentiel dans cette gestion pendant des décennies. Perdre ce produit, représenterait un recul majeur, surtout sans une solution de rechange viable et à grande échelle.
L’histoire de Bayer ne concerne donc pas qu’un simple herbicide. Elle illustre la collision entre la crédibilité scientifique, l’activisme juridique et la perception publique menant à des conséquences bien concrètes. Et au final, les consommateurs en paieront probablement le prix.
Si l’on vise un système alimentaire plus sécuritaire et durable, les décisions entourant les outils agricoles doivent s’appuyer sur des données probantes, et non sur la peur, l’émotion ou les considérations politiques. La meilleure voie pour Bayer serait possiblement celle de l’innovation : créer une solution que les agriculteurs adopteraient, que les régulateurs approuveraient, et que la société accepterait.


